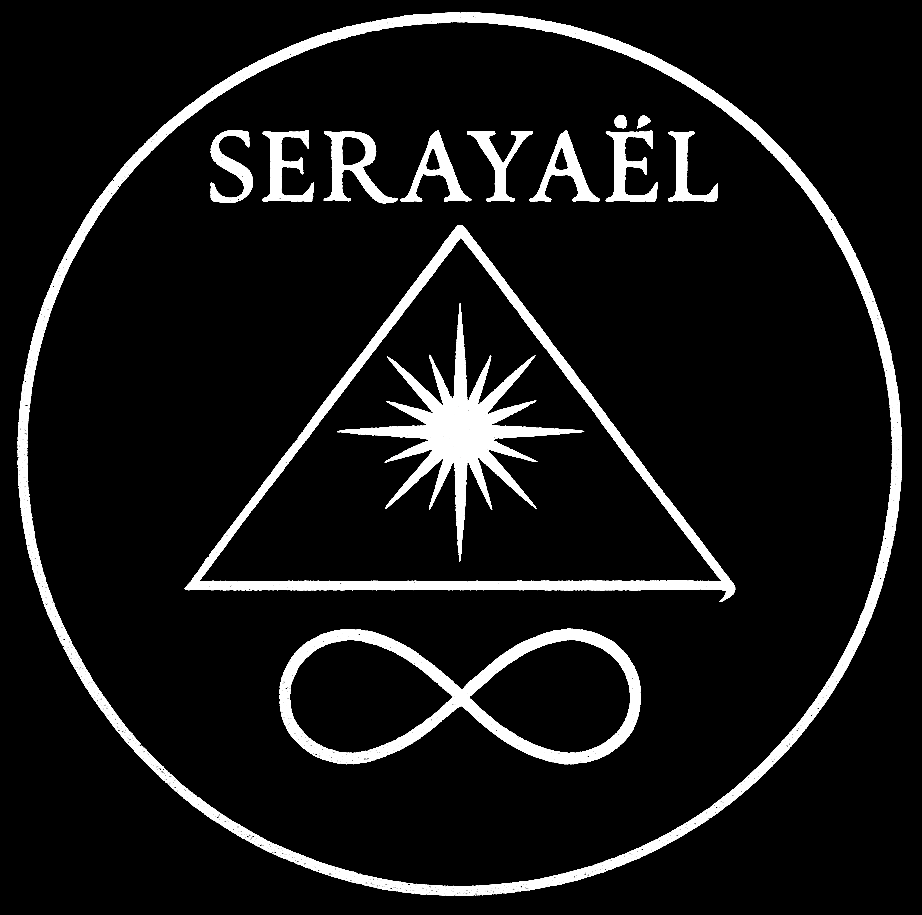Le pouvoir vibratoire des mots : quand le Verbe devient énergie créatrice
Et si chaque mot que nous prononcions vibrait au-delà du silence ? Et s’il était plus qu’un simple outil de langage — une onde, une intention, une pulsation énergétique en mouvement ? Le mot possède un pouvoir que nous avons souvent oublié : celui de créer, de transformer, d’ouvrir ou de refermer. Un mot peut élever une âme ou la diminuer, éveiller une conscience ou nourrir une illusion. Il a le pouvoir de guérir ou de blesser, de guider ou d’égarer. Ce n’est pas tant le mot lui-même qui agit, mais ce qu’il active. La réaction émotionnelle, la résonance qu’il touche en nous. Les mots sont comme des portails, des symboles chargés d’histoire, de vécu, de mémoires. Selon notre sensibilité, ils appuient sur certains nœuds, réactivent certaines blessures, réveillent certains maux. Les jeux de mots ne sont donc pas anodins — ils révèlent souvent les couches cachées du langage et les dynamiques énergétiques à l’œuvre. Prendre le temps de revenir à la source des mots, à leur définition originelle, c’est aussi se libérer des mensonges que l’on entretient sur leur sens. Car mal nommer, c’est mal comprendre. Et mal comprendre, c’est mal vibrer. Le langage, au fond, ne reflète pas la réalité : il la façonne, il la projette, il la fait exister.